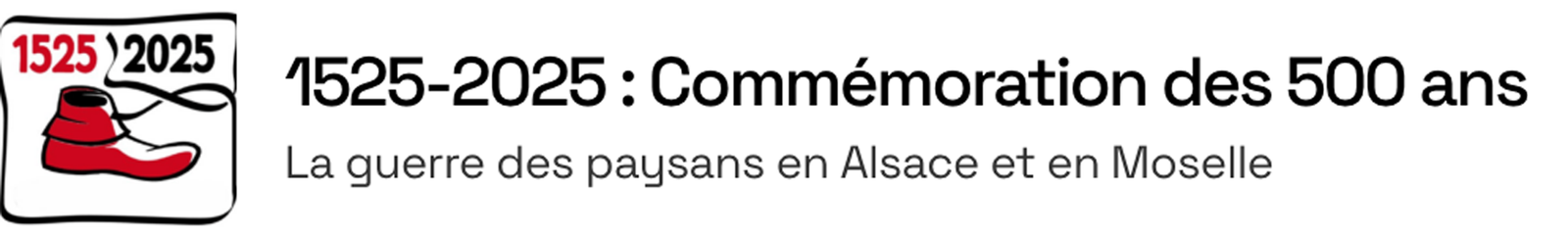L’Histoire de la guerre de paysans

La Guerre des Paysans, ou Bauernkrieg, est un conflit majeur qui a secoué le Saint-Empire romain germanique entre 1524 et 1526. Au début de l’été 1524, un premier soulèvement éclata en Haute-Souabe, près du lac de Constance. Après un hiver sous tension, dès le mois de février, la révolte se propagea dans le Wurtemberg, en Franconie, en Thuringe, en Styrie et dans le Tyrol. Au printemps, 1525, l’Alsace, une partie de la Lorraine (bailliage d’Allemagne) et le nord est de la Franche- Comté rejoignirent cette vaste insurrection. Des bandes armées de paysans et d’artisans s’organisèrent, revendiquant un nouvel ordre social basé sur davantage d’équité face aux pouvoirs ecclésiastique et seigneurial, une meilleure répartition des impôts, l’abolition du servage et une plus grande autonomie rurale, notamment à travers le manifeste des Douze Articles.
Les origines de cette insurrection hors normes pour l’époque sont multiples, mêlant des revendications sociales et politiques héritées des conjurations appelées Bundschuh, avec l’impact de la Réforme luthérienne. Bien que Luther ait initialement critiqué l’ordre établi, il prit prétexte de la violence de certains insurgés pour condamner le soulèvement dans son ensemble. Il exhorta les princes du Saint-Empire à briser impitoyablement le mouvement émancipateur.
En Alsace, le soulèvement débuta en avril 1525, avec la formation de plusieurs bandes, dont la principale était dirigée par l’artisan tanneur Érasme Gerber. Le mouvement s’étendit rapidement au Westrich (vallée de la Sarre), à la montagne vosgienne et au nord est de la Franche- Comté. Le mouvement prit une ampleur significative dans les possessions du duché de Lorraine, incitant le duc Antoine à intervenir militairement. Sa propre armée étant trop faible pour briser cette propagation, Antoine de Lorraine sollicita son frère, le comte Claude de Guise, qui commandait une armée française en Champagne. Les deux frères obtinrent une trêve dans le conflit entre le Royaume et le Saint-Empire, et engagèrent leurs troupes respectives dans une expédition militaire impitoyable.
La répression fut rapide et sanglante, culminant dans la destruction des principales bandes insurgées en quelques jours. Les combats de Saverne et de Lupstein furent particulièrement meurtriers, aboutissant à un massacre des insurgés ; la bataille de Scherwiller marqua une autre défaite significative. Des affrontements se poursuivirent en Alsace méridionale et autour de la porte de Bourgogne, où les rebelles furent finalement dispersés par les autorités locales. Malgré une résistance parfois tenace, le soulèvement fut maté, entraînant une sévère répression dans certaines des régions touchées. Les évaluations du nombre de morts oscillent entre quinze et trente mille victimes (on parle de cent mille pour l’ensemble du soulèvement dans le Saint Empire).
Comme dans les autres provinces impériales, la Guerre des Paysans en Alsace, Lorraine et Franche-Comté eut un impact durable sur la mémoire collective, notamment à travers des récits historiques, des chansons populaires et des légendes locales. Bien que souvent interprétée sous un angle religieux à l’époque, les analyses contemporaines mettent en lumière les dimensions sociales et politiques de cette révolte. Aujourd’hui, ce sont cinq pays d’Europe qui sont concernés régionalement par la mémoire de la guerre des Paysans. Plusieurs historiens soulignent la parenté de cette vaste insurrection avec la Révolution française.
Source : synthèse de la page Wikipédia « Guerre des paysans en Alsace, Lorraine et en Franche Comté ».